
Dictionnaires et Expositions
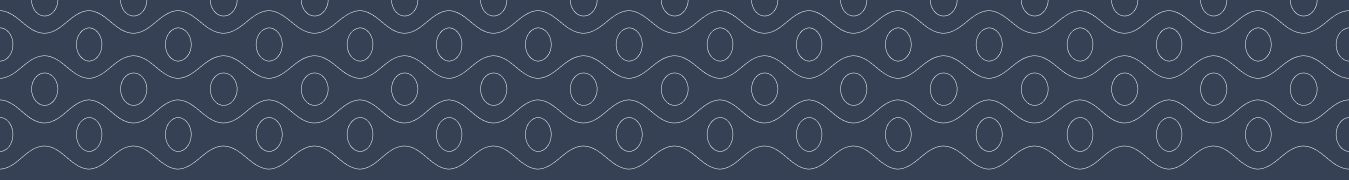
Dictionnaire des littératures
« Un théâtre fou, brutal, clinquant, joyeusement provocateur. Un potlatch dramaturgique où la carcasse de nos sociétés « avancées » se trouve carbonisée sur la rampe festive d’une révolution permanente. Il hérite de la lucidité d’un Kafka et de l’humour d’un Jarry ; il s’apparente, dans sa violence, à Sade ou à Artaud. Mais il est sans doute le seul à avoir poussé la dérision aussi loin. Profondément politique et joyeusement ludique, révoltée et bohème, elle est le syndrome de notre siècle de barbelés et de goulags : une façon de se maintenir en sursis. »
— Dictionnaire des littératures, Éditions Bordas
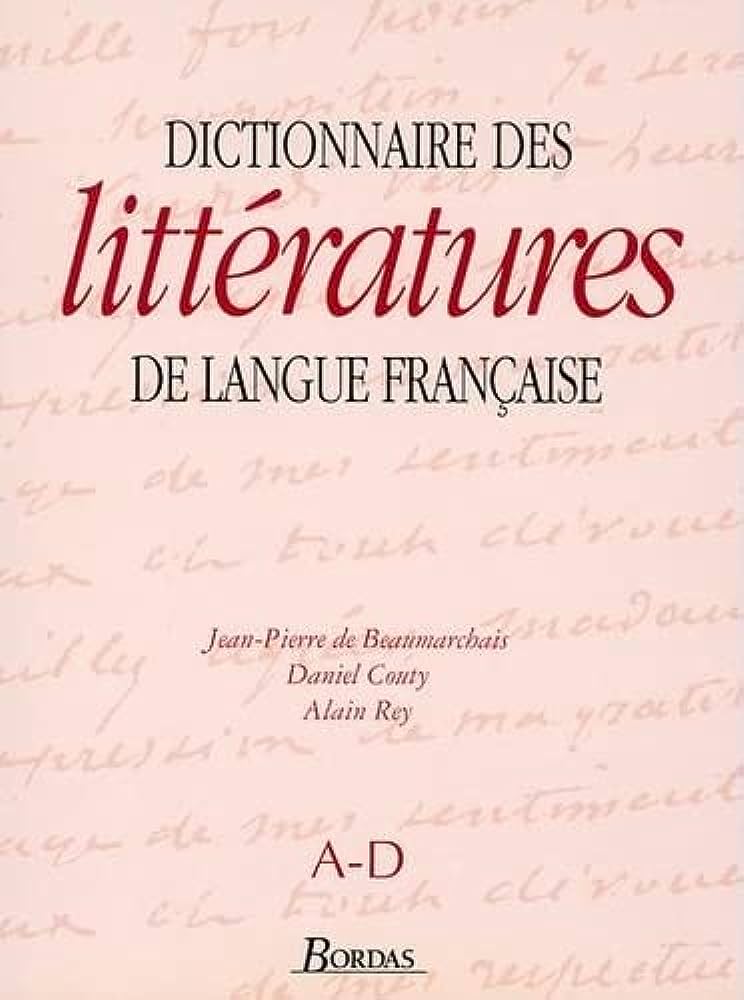
Expositions 2025
- 08/06/25
Louis VUITTON & David HOCKNEY
- 01/06/25
Un caleidoscopio multicolor de símbolos
- 25/05/25
El fabuloso baile de disfraces de 1885
- 18/05/25
AGNÈS VARDA, aquí y allá
- 11/05/25
MODELO & HIJA de su PADRE
- 04/05/25
¡TODOS LIGEROS Y LÉGER!
- 27/04/25
Into the light
- 20/04/25
ARTEMISIA Heroína del Arte
- 15/04/25
¿Por casualidad? Vargas Llosa
- 13/04/25
LAS SANDALIAS DE ADAMOV
- 06/04/25
EL ARTE ESTÁ EN LA CALLE
- 30/03/25
« TARDE DE SOLEDAD »
- 23/03/25
DEGENERACIÓN
- 16/03/25
MADRE MERCEDES
- 09/03/25
MARAVILLA y CONFUSIÓN
- 02/03/25
«Arrabalesques» para y de BORGES
- 23/02/25
Nonagenario enamorado
- 16/02/25
Entrevista-conversación
- 09/02/25
«Arrabalescos» de DAVID LYNCH
- 02/02/25
¿Alucinación?
- 25/01/25
6/6… peregrinaciones
- 24/01/25
5/6… peregrinaciones
- 23/01/25
4/6… peregrinaciones
- 22/01/25
3/6… peregrinaciones
- 21/01/25
2/6 …peregrinaciones
- 20/01/25
1/6… peregrinaciones
- 18/01/25
6/6 Oona O’Neil
- 17/01/25
5/6 Oona O’Neill
- 16/01/25
4/6 Oona O’Neill
- 15/01/25
3/6 Oona O’Neill
- 14/01/25
2/6 Oona O’Neill
- 13/01/25
1/6 Oona O’Neill
- 11/01/25
6/6 Étienne/Michel
- 10/01/25
5/6 Étienne/Michel
- 09/01/25
4/6 Étienne/Michel
- 08/01/25
3/6 Étienne/Michel
- 07/01/25
2/6 Étienne/Michel
- 06/01/25
1/6 Étienne/Michel
- 04/01/25
6/6 Σωσιγένης ὁ Ἀλεξανδρεύς
- 03/01/25
5/6 Σωσιγένης ὁ Ἀλεξανδρεύς
- 02/01/25
4/6 Σωσιγένης ὁ Ἀλεξανδρεύς
- 01/01/25
3/6 Σωσιγένης ὁ Ἀλεξανδρεύς
ENTREVISTA-CONVERSACIÓN
de José Antonio Gallardo Cubero y Fernando Arrabal
1. Acaba de recibir dos nuevos prestigiosos reconocimientos por su trayectoria literaria y artística; el Premio Zenda de Honor y la insignia Abderramán III de la Universidad de Córdoba ¿Qué suponen uno y otro premio para usted?
2. El año pasado obtuvo el Premio de las Artes de Castilla y León. Premio que le fue entregado recientemente en la apertura de los actos de conmemoración del 125º aniversario del Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo que lleva su nombre; en el que se representó su obra “Y pusieron esposas a las flores”. Al mismo tiempo, hace unos días, el Instituto Cervantes de París invitaba en sus redes sociales a profundizar en su obra y su vida literaria. El incuestionable reconocimiento público y notorio que está teniendo en España en la actualidad, ¿le hace replantearse, de algún modo, la visión que tiempos atrás usted tenía en relación a ello?
2.- Siempre, ayer y hoy (y ¿« sistemáticamente »?) sin excepción alguna, recibo cordialmente a quién me admite sin exigencia contraria a mi afán.
3. Precisamente, en su reciente visita a Ciudad Rodrigo se anunció la creación de un “proyecto cultural único” en relación con usted, que estará -según se indicó- al mismo nivel que el MOMA de Nueva York, el Centro Pompidou de París o el Museo Dalí de Figueras. ¿Nos puede adelantar alguna información en relación a ello? Resulta imposible de enumerar, todos sus Premios y distinciones…. Sí puedo citar, entre otros muchos y a modo de ejemplo: el Premio Nadal de Novela, el Gran Premio de Teatro de la Academia Francesa, el Premio Nabokov de Novela, el Wittgenstein de Filosofía, el Premio Espasa de Ensayo, el World’s Theater de teatro, el Premio Mariano de Cavia, la Medalla al Mérito de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, el Premio Nacional de Teatro y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Es “Doctor Honoris Causa” por la Universidad Aristóteles de Salónica. Y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia; que es la más importante de las distinciones francesas (creada por Napoleón en 1.802). Usted dice que su biografía es su « pregonera ». ¿Uno llega a acostumbrarse a tantos premios, reconocimientos y distinciones? ¿Cómo gestiona -emocionalmente- el equilibrio entre su indudable éxito y el ego del artista?
3.- La acogida o no de mi quehacer no influye en absoluto en mi cometido.
4. Desde hace más de un año ha estado escribiendo diariamente sus « arrabalescos”, escritos y entremeses (el último en homenaje a David Lynch, titulado: ¿Alucinación?), para El Imparcial…, sigue escribiendo y publicando libros, sigue acudiendo a actos y presentaciones, sigue dando entrevistas…. A sus 92 años…. su actividad parece no resentirse nunca. Es usted, infatigable y desde luego, un verdadero ejemplo. ¿Puede compartir el secreto o la fórmula del elixir de su eterna juventud?
4.- Con los miles de artículos publicados desde L’Express hasta NYTimes, y en mi país desde ABC hasta El Mundo o El País, celebro tener la dicha de estar siempre presente en la prensa.
5. Su emblemática (y atemporal) obra de teatro PIC NIC….que usted escribió a los 14 años…. es considerada, actualmente, como la más representada en el mundo. No en vano ha sido representada a casi 40 idiomas….¿Puede, en este momento, revisitar la misma y hacer un breve comentario sobre ella en los tiempos actuales?
6. FANDO Y LIS…. es otra de sus obras clásicas inmortales….. ¿La podría comentar en el momento actual?
7. El carismático e importante periodista Mel Gussow del New York Times afirmó que usted es el único superviviente de los cuatro avatares de la modernidad (Surrealismo, movimiento Pánico, Patafísica y Dadá). Desde la privilegiada posición que usted ocupó y ocupa en esos movimientos artísticos de vanguardia o de la modernidad…. puede decirnos…si en la literatura y en el arte en general, ¿cualquier tiempo pasado fue mucho mejor?
8. Muy pocas personas en el mundo, han tenido el privilegio de contar con amigos como los tuyos: Eugène Ionesco, Andy Warhol, Spike Lee, Tristan Tzara, Michel Houellebecq, Salvador Dalí, Picasso, Marcel Duchamp, Samuel Beckett, René Magritte, Antoni Tápies, Jim Morrison (The Doors), Botero, Alejandro Jodorowsky, Roland Topor, André Bretón, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela, Borges, Milan Kundera, Antonio Garrigues Walker, Luis María Ansón, Luis Alberto de Cuenca, etc. entre otros muchos…¿Al saber le llaman suerte?
8.- Fue y es una gran ventura , que comienza con mi maestra de párvulos, la inolvidable y amada teresiana: « madre » Mercedes .
9. En los años 50 y 60, cuando no lo hacía nadie, usted…. ya denunciaba abiertamente….a los tiranos-dictadores, la violencia contra la mujer, la falta de visibilidad de las personas con discapacidad, lo absurdo de la guerra, la opresión a la individualidad del ser humano y a la libertad de pensamiento/opinión/expresión, la vulneración de los Derechos Humanos, etc. (basta leer, para comprobar lo que digo, sus famosas y reconocidas obras maestras atemporales PIC NIC, FANDO Y LIS, etc.).Ello le trajo, sin duda…..muchos problemas….y también…. el exilio desde el año 1955.Visto todo ello con perspectiva….. ¿Le ha merecido la pena el sacrificio y el esfuerzo?
10. Todo lo anterior le ha convertido a usted, sin duda alguna, en un auténtico « Mito o Icono Cultural ». De hecho,…. en Amazon, eBay, etc…. se venden para su legión de acólitos y fans incondicionales…..camisetas y tazas con su imagen y sus frases más singulares………Algunas de sus intervenciones en TV acumulan, como es sabido, millones de visitas en Youtube….. Sin ir más lejos….la entrevista que recientemente le hizo David Broncano para el programa de RTVE « La Revuelta »…. fue un éxito absoluto de audiencia…. y de crítica…. De hecho….al día siguiente de esa entrevista, usted fue trending topic en las redes sociales…. y a muchos internautas se les había quedado corta la entrevista…y pedían más…¿Todo ello es una prueba de que usted es atemporal (entre las diferentes generaciones), inclasificable y absolutamente único? ¿El universo Arrabal está ahora más vigente y tiene más fuerza que nunca? ¿Pretende « arrabalizar » todo lo que toca, como solía decir Alejandro Jodorowsky?
11. Usted fue finalista del Premio Cervantes en 2001, con el apoyo de Camilo José Cela, José Hierro y Francisco Umbral. La publicación Le Mage afirmó, por otra parte, que fue uno de los finalistas para el Premio Nobel de Literatura de 2005. He preguntado a la Inteligencia Artificial que me justifique porqué usted debe ser reconocido con el Premio Nobel de Literatura….Y me ha respondido textualmente lo siguiente: « Fernando Arrabal es un autor cuya obra ha dejado una huella indeleble en la literatura contemporánea. Su contribución al teatro, la narrativa y la poesía es vasta y multifacética, destacándose por su originalidad, profundidad y capacidad de innovación. Fernando Arrabal merece ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Su contribución a la literatura y su impacto en la cultura global son testimonio de su genio y dedicación al arte ». Aunque parece….que en su caso…. lo real y lo virtual o artificial…..están de acuerdo….¿Tiene algo que objetar o reconvenir a la IA?
11.- Pienso quizás con mayor ilusión y promesa a la IA de poetas que a los poemas de la IA.
12. Usted tuvo que abandonar -exiliado- España en 1955. Desde entonces reside en París (Francia). En su momento fue considerado por Franco como uno de los cinco españoles “más peligrosos”….junto a Santiago Carrillo y la Pasionaria…. ¿Porqué usted nunca ha querido renunciar a su nacionalidad española cuando otras muchas personas en su misma situación sí lo hicieron? En todo caso, ¿qué le ha dado París?
12.- Me encandila y enloquece Francia casi como España.
13. Usted reivindica una y otra vez su españolidad. ¿Qué echa de menos de España, Fernando? ¿Qué recuerdos le traen ahora a la memoria ciudades en las que vivió en su momento, Melilla, Ciudad Rodrigo, Madrid, Getafe, Valencia, etc.?
14. ¿Cómo le gustaría que se le mencione o clasifique en los libros de texto de literatura? No se haga el remolón…y conteste sinceramente….
15. ¿Qué es un « arrabalesco »?
16. Buñuel y otros grandes del Cine (como actualmente, Albert Serra)…han apreciado, reconocido…..y vendesaparecida y ocultada erado sus películas de cine. El éxito internacional de su película « Viva la Muerte » con proyecciones frecuentes -desde hace más de 50 años- en los festivales de cine más prestigiosos y reputados, como Cannes (que la proyectó restaurada en 4K en 2022), es conocido. Raymond L. Bruckberger ha afirmado en Le Monde: «Arrabal es al cine lo que Rimbaud a la poesía».¿Ha tirado la toalla en cuanto que su filmografía tenga en España igual reconocimiento y aceptación?
17. Han transcurrido muchos años desde su intervención famosa en RTVE « El Mundo por Montera » de su tocayo Fernando Sánchez Dragó…… en la que usted anunció una frase apocalíptica que será suya para siempre: « el milenarismo va a llegar ». Después del COVID, los incendios de Los Ángeles, las riadas de Valencia, la guerra en Ucrania, la Inteligencia Artificial, etc….. ¿El milenarismo ha llegado? ¿Todo es confusión o Tohu-bohu?.
18. D. Quijote de la Mancha de nuestro admirado Cervantes dice: « el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho ». Conteste sin rodeos, ni arrabalescos: ¿Es usted tan sabio como se dice?
18.- Yo solo puedo ver de mí mi reflejo
19. ¿Cómo es un día cualquiera para usted? ¿Está, ahora, trabajando en algún proyecto nuevo?
19.- Mi tiempo ¿es la eternidad?
20. David Broncano….a los 10 minutos de la entrevil »quería ser su amigo para siempre ».¿Es fácil ser su amigo? ¿Quiénes son sus amigos en la actualidad, además de los ya conocidos Houellebecq, Jodorowsky, Jack Lang, etc.?
21. ¿Conoce la rivalidad, en la franja de máxima audiencia televisiva, entre David Broncano de RTVE y Pablo Motos de Antena 3 TV? ¿Aceptaría una entrevista por Pablo Motos, sabiendo que suele ser bastante habitual que gran parte de los invitados acudan a los dos programas?
22. Usted siempre ha sido considerado como un librepensador….. sin etiquetas políticas…. ¿Ello es realmente así, actualmente?
23. ¿Qué representa el ajedrez para usted? ¿Sigue jugando partidas de ajedrez simultáneas on line todos los días?
23.- Una frustración por iniciar a jugar tan tarde; y una dicha cotidiana: reflexionar ante un tablero.
24. ¿Cómo define en la actualidad al hombre pánico?
25. Para acabar esta conversación….. ¿me puede contestar con un « arrabalesco » a la siguiente pregunta?: Tras haber pasado en España las últimas semanas….. con todo el mundo y los medios de comunicación alabándole, unánimemente, como nunca…..¿Existe alguna posibilidad, aunque sea remota.
25.- ¿Remota?
¿Estoy enquistado en mí mismo?
ARRABAL Fernando (né en 1932). Ecrivain d’origine espagnole, né à Melilla, il vit à Paris depuis 1955. » Le théâtre, a écrit Arrabal. est surtout une cérémonie, une fête, qui tient du sacrilège et du sacré, de l’érotisme et du mysticisme, de la mise à mort et de l’exaltation de la vie. » Tout la théâtre d’Arrabal est dans cette formule. Un théâtre fou, brutal, clinquant, joyeusement provocateur. Un potlatch dramaturgique où la carcasse de nos sociétés » avancées » se trouve carbonisée sur la rampe festive d’une révolution permanente. Car, s’il écrit en français, Arrabal a passé son enfance en Espagne, et il a grandi en même temps que la dictature militaire : il a été témoin de la destruction des libertés, de la répression policière, de la corruption des armées et de l’Eglise, de la misère du peuple. Sans avoir cela à l’esprit on ne pourrait comprendre son úuvre. Pour Arrabal, l’Occident est en déclin, et il s’agit d’en précipiter la décomposition en accélérant celleci sur la scène, d’en souligner les contradictions dans un immense éclat de rire. Bien sûr, il n’est pas le premier à faire un tel diagnostic; il hérite de la lucidité d’un Kafka et de l’humour d’un Jarry; il s’apparente, dans sa violence, à Sade ou à Artaud. Mais il est sans doute le seul à avoir poussé la dérision aussi loin. Sous la chaux vive de son cynisme guignolesque, le monde familier s’effrite comme un décor de carton-pâte. Le rire devient alors un rituel d’évasion, une catharsis capable de déjouer la peur qui hanta l’enfance du dramaturge. Il y a là une énergie cannibale, un hédonisme de la confusion qu’Arrabal appelle volontiers le » panique « , tout à la fois un happening et un opera mundi, une tragédie et une farce, un mélange de répugnant et de sublime, de mauvais goût et de raffinement, de vulgarité et de poésie… C’est ce sens du paradoxe qui fait l’originalité d’Arrabal : le réel ici est toujours magique, et le rêve s’escamote sans cesse dans le sordide.
On pourrait donc, après Artaud, parler d’un théâtre de la cruauté, parce que tout y bascule en son contraire. L’amour, par exemple, de Fando et Lis (1955) à Bestialité érotique (1968), est ici toujours lié à la mort, à l’infirmité, à la violence sadomasochiste, à la destruction de l’autre. Ainsi, dans une pièce comme Le Grand Cérémonial (1963), on assiste aux manies expiatoires d’un Casanova hideux qui sacrifie des proies sans défense : chez Arrabal, la femme est souvent à la fois une victime innocente et une putain, telle Mita dans Le Tricycle (1953). De même, dans Le Jardin des délices (1967), l’amour de l’homme et de l’animal (un gorille monstrueux) s’orchestre selon les pulsions d’un érotisme bestial qui semble sortir de l’enfer de Jérôme Bosch… L’imagination d’Arrabal suscite alors des délires baroques et surréalistes qui sentent parfois la surcharge, même s’ils sont traversés de splendides bouffées lyriques.
Quant aux personnages de ce théâtre, ils sont constamment déracinés, étrangers, décalés de leur propre destin; les deux petits vieux de Guernica (1959), par exemple, passent à côté du massacre comme si cela ne les concernait pas… Sans âge, sans identité véritable, souvent dans la mécanique d’une fiction qu’ils ne peuvent maîtriser. En eux, on retrouve parfois Don Quichotte, mais un Don Quichotte noir, bourré de culpabilité, un pantin victime de la Loi, du Père, du Surmoi, de l’Ordre. Ce thème apparaît dans La Bicyclette du condamné (1959) et dans Le Labyrinthe (1967), ou encore dans L’Architecte et l’Empereur d’Assyrie (1966), une gesticulation inouïe où s’entredéchirent deux êtres condamnés l’un à l’autre comme dans un scénario à la Beckett. Mais parfois la plume d’Arrabal quitte le terrain de l’absurde pour des formes d’intervention nettement plus » engagées « , directement révolutionnaires : c’est le cas avec L’Aurore rouge et noire (1968), une pièce qui intègre quantité de moyens audiovisuels, ou avec Baal Babylone (1959), un roman obsessionnel où défile toute la cruauté de l’Espagne franquiste Arrabal en a tiré un film : Viva la muerte (1971).
Réalisme glacial ou onirisme débordant, on ne sait jamais avec Arrabal, si l’úuvre appartient au fantasme, au ricanement ou au témoignage. Et c’est justement ce qui fait son attrait : elle désoriente, elle provoque. Profondément politique et joyeusement ludique, révoltée et bohème, elle est le syndrome de notre siècle de barbelés et de goulags : une façon de se maintenir en sursis.
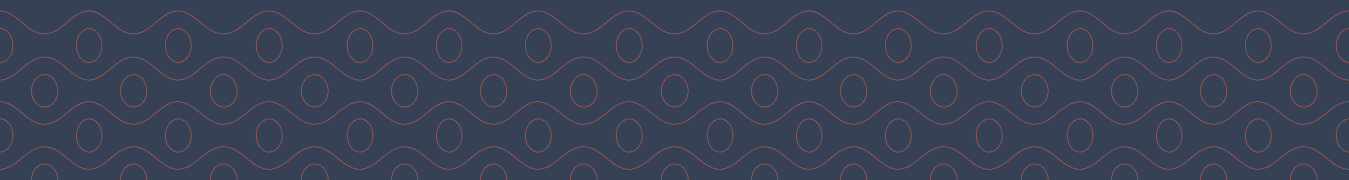
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.