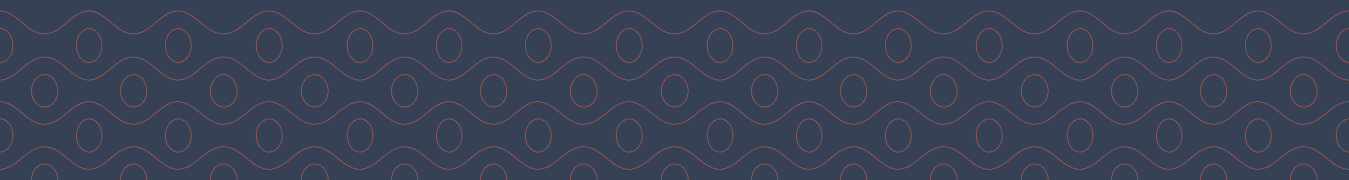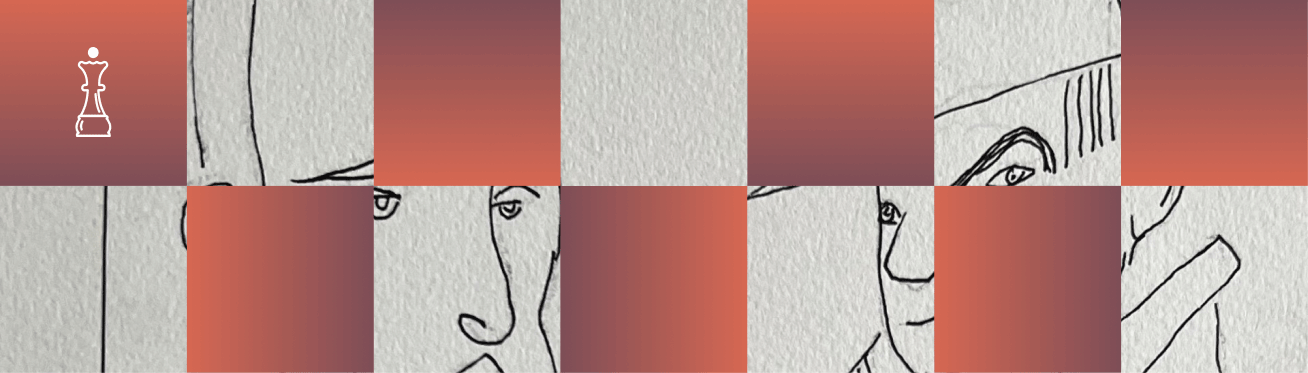
Kundera
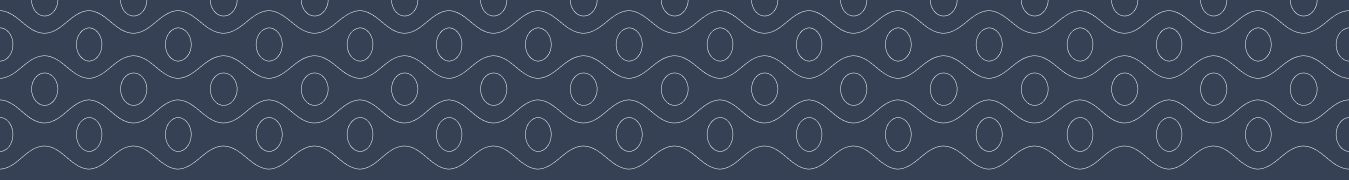
Milan Kundera

Fernando Arrabal, l’homme qui joue
On a vu des joueurs pour qui rien n’est sérieux. Et on a vu des hommes qui bravent les tribunaux et la prison. Mais on voit rarement des joueurs qui ne prennent rien au sérieux et bravent les tribunaux et la prison. Même s’il défie Franco et Castro, Arrabal n’est pas un contestataire, un prêcheur militant; c’est un homme qui joue; l’art tel qu’il le conçoit est un jeu, et le monde devient un jeu dès qu’il le touche. Mais ce siècle est un terrain interdit aux jeux, une trappe creusée pour les joueurs. Et ils passèrent des menottes aux fleurs, cette pièce inspirée par les prisons de Franco, est la première que j’ai lue de lui; c’était à Prague ou d’autres maîtres de prisons régnaient alors; je me disais : un jour, nos horreurs seront oubliées, mais cette pièce d’Arrabal, cette merveille sale, orchidée d’imaginations dépravées, cette magnifique fleur fétide du mal, cette pièce restera. Je me suis trompé, bien sûr. Ce n’est pas cette pièce, hommage suffocant à Sade, qui restera, mais les images d’Epinal du nouveau rewriting de l’histoire, lesquelles, dès aujourd’hui, imposent leur vision édifiante des décennies passées car, du ventre de ce siècle, sérieux et bête, ne naîtra qu’un sérieux encore plus sérieux, une bêtise encore plus bête. » Le monde est devenu mortellement, absurdement sérieux « , a dit Gombrowicz à ses critiques et ils l’ont applaudi en le transformant sur-le-champ en écrivain sérieux à mourir.
Comment s’appelle l’étoile sous laquelle vous avancez, ô Arrabal? Marx, Anti Marx, Tocqueville, Sartre, Mandela, Bush? Rien ne vous est plus indifférent que cette honorable mafia de l’Histoire. Votre étoile porte le nom de Cervantès. Quand, un jour, vous l’avez avoué en levant solennellement la main vers le firmament, le public autour de vous (public des Marx ou des Anti Marx ? n’importe), croyant entendre une charmante incongruité, éclata de rire. (Vous le savez bien: on réussit à les faire rire seulement aux moments où l’on est le plus sérieux.) Avec la lumineuse clarté du non-sens, vous avez ensuite exprimé le même aveu dans La fille de King Kong, le dernier livre que j’ai lu de vous. C’est un roman-jeu, et chacun des jeux, football, rugby, échecs, est une prison de règles belle comme la forme exquisément accomplie. Contrairement au joueur d’échecs, l’artiste s’invente des règles lui-même pour lui-même, étant à la fois l’architecte de la prison et le prisonnier. La fille de King Kong: cinquante chapitres dont chacun (jamais plus long que trois pages) contient: 1) un fragment de l’histoire de la protagoniste; 2) son évocation de Cervantès (jamais plus longue qu’un paragraphe); 3) un ou deux proverbes (à l’instar de ceux de Sancho) et 4) une phrase sibylline à la fin. Les jeux sont dangereux: il y a des proses, des mécanismes d’écriture si savamment, si austèrement, si désespérément ludiques qu’on y meurt étranglé d’ennui.
Comment avez-vous réussi, ô Arrabal, avec les règles monacalement sévères et régulièrement appliquées, à rester si impudiquement drôle?
Comment avez-vous fait pour qu’un personnage irréel et impossible, tombé de la roulette des règles et des calculs, m’ait ému à tel point que j’ai lu ses aventures totalement absurdes sans pouvoir m’arrêter, d’une seule haleine? Elle est éduquée dans un internat religieux, devient putain, réussit à égorger ses deux maquereaux, se sauve en Amérique; le vieux patron du gang la poursuit, veut la tuer et finit par être séduit: pas par son corps, ni par son âme, mais par son amour de Cervantès auquel elle pense constamment durant toutes ses aventures. C’est lui, Cervantès, le dieu de ce roman. Dans le dernier chapitre, le patron-tueur est juché sur un âne, la putain-cervantophile sur un cheval et ils s’éloignent, l’un à côté de l’autre, sous la toile d’étoiles, au loin, dans les prairies d’Amérique. O Cervantès, notre père, que ton nom soit béni, reste avec nous, car sur la terre, cette terre mortellement sérieuse et qui ne nous aime pas, nous sommes esseulés et n’avons que toi.
amado mío Kundera

Version française
K U N D E R A
noir et profond comme des verrous aveugles
rien ne peut tuer mon chagrin
de perdre celui qui mesurait le mieux
l’ombre de l’ombre le vacarme
le tumulte et la fureur de ses épisodes rouges
comment vivre sans toi ? te cherchant sans repos
quand peu à peu tu traverses le cosmos et atteins le Soleil
en paraphant au fil de ton oeuvre des courbes des spirales
comme les heures sont douloureuses ! et les sanglots inutiles
tu n’expires pas tu ne trépasses pas tu ne péris pas
Milan bien-aimé au fil de ton oeuvre
tu ne succombes pas tu ne t’occultes pas tu ne t’effondres pas
sous les guirlandes dont ta cause t’as privé
hier Cervantes et même Teresa
quelle ruse ont-ils utilisée ? avec quelle pugnacité ?
comme toi Milan quand toi Tchèque devenu parisien dans l’âme
tu as fait ton chemin d’humilité et de puissance et de vigueur
tu m’as tant donné au galop de l’altruisme
sans écouter les trompettes du prosélytisme
que j’ai dû écrire moi-même ici
ce que le soviétisme ne voulait et ne pouvait lire
dans l’atelier tu as pris ma petite main
tu l’as gardée prisonnière de tes mains de géant
et là tu m’as posé une question
à laquelle je ne pouvais que répondre
comme un colibri sur son rivage penché
tu as toujours été et tu es toujours poète
mon bien-aimé
consubstantiel
sublime
et donquichottesque
Versión español
K U N D E R A
negra y profunda como ciegos cerrojos
nada puede matar la pena mía
de perder a quién mejor medía
la sombra de la sombra la algarabía
el cisco y tumulto de sus episodios rojos
¿cómo vivir sin ti? ¿buscando sin reposo?
cuando atraviesas el cosmos y vas llegando al Sol
rubricando el cielo ¿con curvas de caracol?
¡cómo duelen las horas! con el inútil sollozo
no expiras ni la espichas ni pereces
Milan amado al filo de tu encausa
ni sucumbes ni te ocultas ni falleces
con tus guirnaldas paradas por tu causa
ayer Cervantes y aun Teresa
¿de qué ardid se valieron? ¿de qué viveza?
como tú Milan al irte a la francesa
hiciste tu vereda de espuma y fortaleza
tanto me diste galopando con altruismo
sin oír los trompetazos del proselitismo
que hube de escribir aquí yo mismo
lo que no quería ni podía leer el sovietismo
en el taller me cogiste mi manita
y allí encerrada en tus manos de gigante
me hiciste una pregunta azogado
a la que solo podía responder
como colibrí a su ribera reclinado
siempre fuiste y eres poeta
amado mío
consustancial
sublime
y quijotescamente